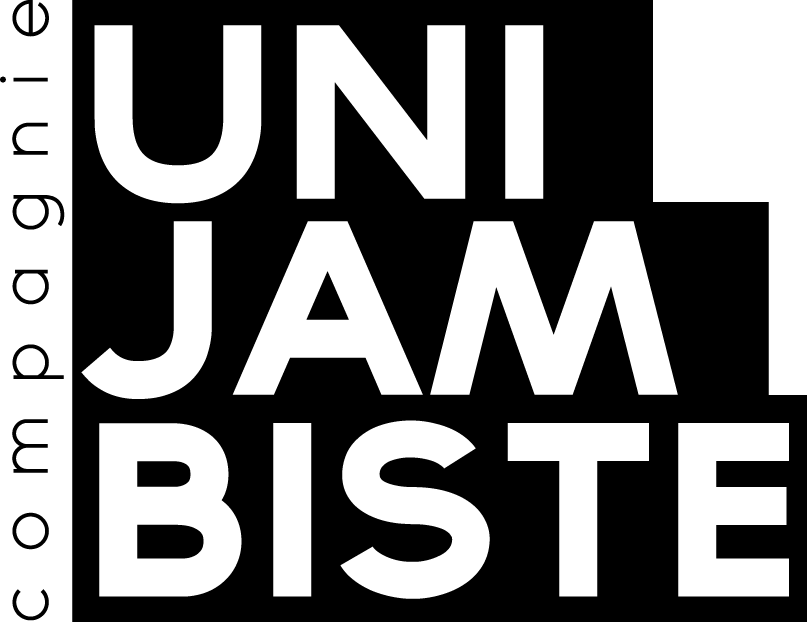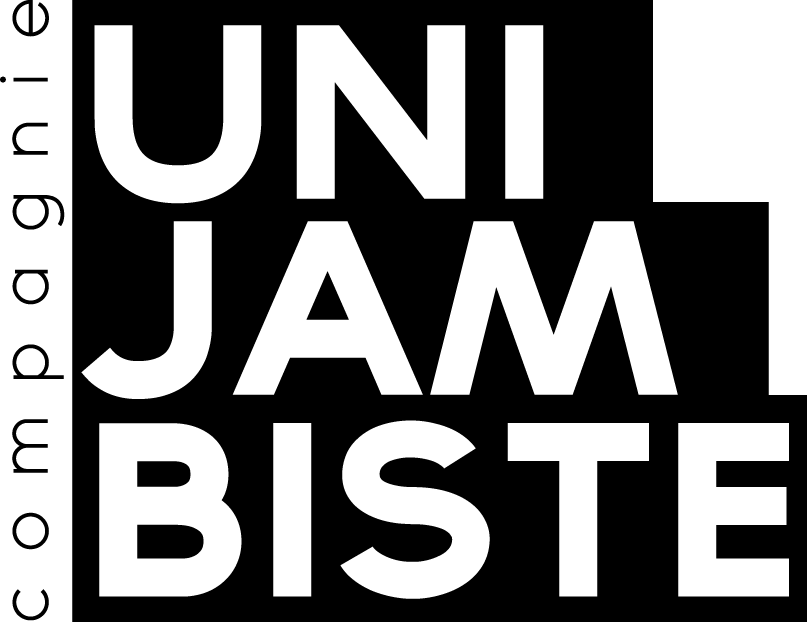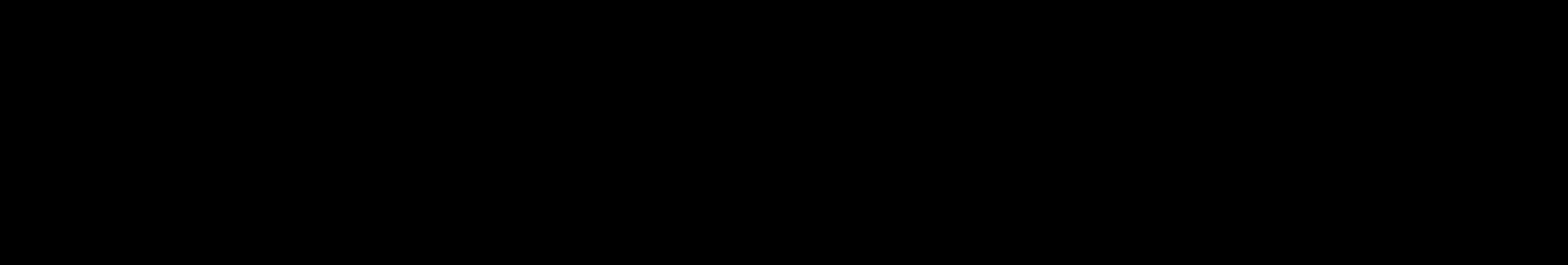Entretien réalisé par Emilie Barrier pour www.theatreoracle.com
Festival des Francophonies, septembre 2014
Racontes-moi ton parcours dans les grandes lignes ?
Ma jeunesse s’est déroulée près du Havre, en Seine-Maritime.
Très tôt, je me suis passionné pour le football. Rêvant de devenir joueur professionnel. Aussi, après plusieurs capitanats et plusieurs sélections, j’ai intégré la section sports études de Saint-Valéry-en-Caux. Mais, bien vite, la vie d’interne et la compétition avec mes camarades m’ont découragé, je rêvais d’un sport d’équipe…
Comme j’étais plus scientifique que littéraire, j’ai opté pour un bac D. En terminale, je découvre le théâtre. Un professeur d’histoire, passionné, m’ouvre les coulisses d’une troupe d’amateurs. Je deviens vite souffleur. A la recherche d’une vraie camaraderie, j’abandonne le football pour le rugby mais me distingue surtout lors des troisièmes mi- temps. A l’IUT de chimie de Rouen, le théâtre universitaire prend alors le pas sur mes études supérieures. Mes amis passent des auditions pour intégrer de grandes écoles, m’entrainant dans une aventure qui me conduit à Cannes.
Contre toute attente, je fais partie de la trentaine de finalistes sélectionnés (parmi 400 candidats), puis admis à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes. Mais, animé par un autre rêve, celui de devenir metteur en scène et chef de troupe, je quitte Cannes pour intégrer l’Académie théâtrale de l’Union, à Limoges.
C’est ainsi qu’a débuté, à la fin des années 1990, mon histoire avec le Limousin.
Silviu Purcarete, le metteur en scène roumain, alors directeur du Centre Dramatique National, me fait confiance et me laisse faire mes armes avec la complicité bienveillante de toute son équipe.
Doyen de la première promotion, je crée L’unijambiste en 1999 avec quelques camarades. Assez rapidement, notre travail atteint la reconnaissance nationale et nos créations, défendues par l’ONDA, tournent sur l’ensemble de l’Hexagone, principalement dans le réseau des Scènes Nationales. L’unijambiste est conventionné par la Drac Limousin et la Région Limousin dès la saison 2007/2008.
Depuis cinq ans, notre budget annuel avoisine régulièrement 450 000 €. Il a toujours été équilibré. J’ai eu la chance d’avoir un administrateur – devenu depuis lors un ami – qui, aujourd’hui retraité, a dans le passé été secrétaire général de la Criée à Marseille, administrateur du CDN de Reims comme du Nouveau Théâtre de Belgique, de tournée pour Bob Wilson … et du Palace à Paris. Un homme précieux.
Nous gardons nos spectacles au répertoire plusieurs années, ce qui nous permet petit à petit d’accroître notre visibilité, jusqu’à jouer au Luxembourg, en Belgique, en Ukraine, en Tunisie, en Suisse ou encore au Canada.
Et c’est ainsi que, après avoir accueilli deux spectacles de notre répertoire, et un an avant le printemps arabe, le Théâtre National de Tunis me passe une commande.
Je propose alors de travailler la pièce Hedda Gabler d’Ibsen, jouée pour la première fois en langue arabe, dans une traduction de Mohamed Driss, pour évoquer – là-bas – la question de la place de la femme d’aujourd’hui dans la société tunisienne, poursuivant ainsi ma recherche sur les oeuvres éponymes interrogeant les icônes du féminisme du théâtre de la fin du 19ème siècle, début 20ème (Mademoiselle Julie de Strindberg, Ekatérina Ivanovna de Léonid Andréiev). Et j’ai appris, avec plaisir et fierté, que le Théâtre National a continué à programmer ce spectacle dans divers festivals tunisiens.
En raison de l’empreinte musicale forte de nos spectacles, on me propose l’organisation de quelques événements, telle la Nuit blanche (festival des Francophonies en Limousin) où je suis chargé de programmer des artistes musiciens de toutes origines.
En 2010, c’est l’invention des Nightshots #1 à la Manufacture d’Avignon où j’ai en charge la programmation et l’organisation de soirées (théâtre, musique, poésie, …) chaque jour différentes pendant toute la durée du Festival.
En 2015 l’Opéra de Limoges me confie la mise en scène d’un grand classique allemand, Der Freischütz de Weber.
De saison en saison, la compagnie a été associée à la Scène Nationale d’Aubusson, à la Scène Conventionnée de Bellac, au Théâtre de Villefranche sur Saône, à la Scène Nationale de Saint Nazaire, au Théâtre de Compiègne, à la Scène Nationale de Chambéry, y inventant toutes sortes de projets visibles ou plus discrets en complicité avec les lieux qui nous accueillent.
Je pense : à une carte blanche exceptionnelle à Bellac où durant deux mois j’ai à charge la programmation et la communication de la Scène conventionnée;
– au spectacle d’inauguration du Théâtre de Saint Nazaire (en co-organisation avec Nadine Varoutsikos et Bérangère Jannelle), suivi pendant la nuit, avec la participation de tout le public, de projections géantes de graffiti numériques « live » sur la façade ;
– à la soirée Electropicale dans une station de ski proche de Chambéry, pendant laquelle le public a dansé toute la nuit, au son endiablé d’un Dj réunionnais, au milieu de projections vidéo sur la neige.
Et pendant toutes ces années, une quinzaine en fait, je suis resté fidèlement en étroite collaboration avec le Théâtre de l’Union. Après Silviu Purcarete et Pierre Pradinas, Jean Lambert-Wild m’invite à sa table et je deviens artiste coopérateur du CDN du Limousin.
Ici, mon travail ne consiste plus à n’être qu’un « simple créateur », mais à réfléchir, collégialement avec les autres artistes coopérateurs, aux orientations du CDN.
Depuis plus de quinze ans, je suis en empathie avec la fonction de directeur d’une telle structure. J’organise annuellement depuis 2009 des rencontres de metteurs en scène. Joris Mathieu, Thomas Jolly, Anne Monfort, Alexis Armengol, Bérangère Jannelle, Nathalie Béasse, Jean-Pierre Baro, Marion Aubert, Marion Guerrero, Matthieu Roy, Arnaud Troalic, Florent Trochel, Charlie Windelschmidt, Valéry Warnotte, Alexis Fichet, Julien Bouffier, Laurent Brethome, Hala Ghosn, Julien Fiséra notamment participent à mon invitation à ces « conversations » où nous échangeons sur l’Art, bien sûr, mais aussi à une manière moderne de diriger une institution. Sans chercher à écrire un manifeste, Il est question ici de partage de l’outil, de parité, de minorités, d’écologie, de financement, d’éducation, de public, de demain.
Membre du bureau national du Syndéac, expert Drac en région Limousin, membre du jury de la sélection de la prochaine promotion à l’Académie Théâtrale de l’Union, je continue à apprendre sur tous les fronts.
Comment opères-tu le choix de tes textes ?
A ce jour j’ai fait un peu plus de dix spectacles, donc je peux regarder en arrière et déceler un dénominateur commun. Au bout d’un moment on se dit : « Tiens, est ce que je ne traiterais pas à chaque fois le même sujet ? » J’ai fait Hedda Gabler, Mademoiselle Julie, Ekatérina Ivanovna, Hamlet, Richard III par exemple. Quel est le dénominateur commun ? L’individu et la société. » Un et Le reste du monde ». Ça c’est un sujet qui m’intéresse. Seul contre le reste du monde. Et ce, même si l’on est un personnage détestable comme Richard. Celui qui est seul n’est pas forcément un pauvre gentil face au méchant reste du monde. J’aime cette tension : le groupe et l’individu. C’est cela qui me parle, et finalement qu’importe le style du texte. Par exemple je vais sans doute travailler prochainement sur une mère prise dans la Manif pour tous…
Mais j’aime aussi et surtout énormément la langue sculptée. J’ai du mal avec la langue sitcom. Quand j’ai monté Des couteaux dans les poules de David Harrower c’était la première fois que je m’attaquais directement à du « théâtre dit contemporain » . Harrower a une langue particulière et ciselée, qui pour moi n’est pas une ennemie mais une amie. Pour Shakespeare, je travaille plus souvent avec André Markowicz qu’avec d’autres traducteurs parce que André travaille sous l’axe du décasyllabe. Il a une métrique particulière qui m’aide. J’aime les textes dont l’écriture a une forme et dont le sujet parle de l’homme face au monde.
Le seul spectacle pour lequel j’ai dérogé à cette règle est Le songe d’une nuit d’été. Je me suis, avec bonheur, laissé embarquer dans une incroyable trilogie avec Hamlet, Richard III, et Le songe. J’avais une tragédie et une pièce historique, j’ai eu envie de faire une comédie. J’en ai eu envie parce que réaliser une comédie est un exercice difficile. Politiquement, je trouvais aussi intéressant de pouvoir faire un Richard III contestataire qu’une comédie. J’avais repris cette phrase de Deleuze : « Le système nous veut triste, il faut arriver à être joyeux pour lui résister ». J’ai fait mienne cette phrase pendant Le songe. Je me suis dit qu’inviter les gens à rire ensemble sur un bon auteur avait de la valeur. Politiquement je trouve cela aussi engageant que de faire un spectacle rentre-dedans qui va critiquer frontalement les formes de tyrannies.
De toute manière, quoi que l’on crée il y a toujours une portée politique, même si je n’aime pas dire cela parce que ça tombe sous le sens. On entend toujours cette même question bateau : « Est-ce que vous êtes engagé ? Est-ce que vous êtes politique ? » . On essaye souvent de coller aux artistes cette étiquette. Les artistes sont comme les autres, ils sont dans les mêmes questionnements sur les gouvernances successives, les partis politiques. On n’est ni plus idiots, ni plus intelligents que les autres. Et si on voulait faire de la politique on en ferait.
Je pense que l’art est politique par essence et qu’il ne doit pas porter la politique. Il n’est pas là pour ça. Il s’exprime comme il veut, l’art. Un jour il exprime un geste politique, et le lendemain pas du tout. L’art, c’est juste un autre endroit du monde. Je ne dis pas que l’art se met au-dessus de la mêlée, je dis juste qu’on cherche trop à le mettre dans la mêlée. Pour moi il est à côté de la mêlée. Même si parfois il s’en mêle !
A partir de quand, pour toi, on parle de contemporain ?
Dans Ekatérina Ivanovna, le dernier spectacle, ce qui était intéressant c’est qu’en travaillant sur un texte de Léonid Andréïev (contemporain de Tchékhov), l’on s’attend à cette fausse imagerie de lenteur tchékhovienne. Pourtant quand on se promène dans les rues de Saint Pétersbourg et qu’on écoute les gens dans la rue, on se rend compte qu’ils parlent vite, normalement en fait. Quand on s’exprime dans sa propre langue au quotidien, on tchatche, on parle vite et c’est du vivant.
Qu’est ce qui fait le contemporain ? Qu’on travaille Tchékhov ou Shakespeare, c’est quand on a une langue vivante, même si elle a été écrite il y a longtemps. Le pari dans Ekatérina Ivanovna était par exemple de ne pas laisser de blancs entre les répliques. « Quand j’ai fini de parler, tu me réponds ». En revanche, si j’ai cinq répliques ou un monologue à jouer, je peux prendre le temps de l’hésitation. Dans la vie on se coupe tout le temps la parole. Pas en ce moment, parce qu’on a un micro et qu’on se le partage, (rires) mais habituellement on se coupe la parole, parce que les idées fusent et que l’on rebondit. J’essaye de donner cette sensation. Pas forcément une sensation de réel, puisque quand on travaille sur de l’alexandrin ou du décasyllabe, on sait qu’on est sur une langue sculptée, mais une sensation de vivant. Pas du réalisme, mais du vivant. Ça, ça me plait.
Est-ce que c’est important pour un metteur en scène de se mettre en péril ?
Oui. Après dix ans de loyaux services à la cause shakespearienne, au classicisme revisité, j’avais envie de me débarrasser de toutes ces étiquettes. Cette année je pars sur plusieurs projets pour essayer de travailler sur des sujets « contemporains ». Pas forcément des auteurs contemporains, mais des sujets contemporains. Cette histoire de La Réunion dans Kok Batay par exemple fait écho à une histoire vraie : celle de l’identité réunionnaise, d’un illustre boxeur de l’île et surtout celle de l’intérieur intime de Sergio Grondin. Donc tout d’un coup je me déplace. A l’étranger et en travaillant avec un conteur. C’est un double déplacement. Quand je vais faire Der Freischütz de Weber à l’Opéra de Limoges je vais faire un opéra en allemand. Deux langues que je ne connais pas, l’opéra et l’allemand. Je vais aussi préparer Taeksis une chorégraphie avec le chorégraphe coréen Kim Sung Yong , pour travailler sur le sujet de la phototaxie, c’est à dire l’attraction-répulsion qu’on a pour la lumière, comme les insectes par exemple qui sont prêts à aller se cramer sur un réverbère. Donc je pars à Séoul, faire de la danse. Pour moi il y a encore un double déplacement, et ce n’est pas encore du théâtre.
Ma prochaine création avec L’unijambiste va s’appeler Inuk, et sera un jeune public à partir de huit ans. Cela non plus je ne l’ai jamais fait. Pour un jeune public ce sont d’autres codes d’écriture. L’idée c’est de partir sans texte pour réinterroger ma propre équipe et sa capacité à travailler autrement. Cette fois, on n’a plus Shakespeare. On n’a plus André Markowicz. On n’a plus les références de toutes les scènes cultes de Shakespeare et de comment tous les metteurs en scène ont réalisé le fantôme dans Hamlet.
Est-ce que c’est toi qui signeras les textes d’Inuk ?
Je vais partir en écriture de plateau. Je vais avoir besoin malgré tout d’un complice d’écriture. Arm, le rappeur avec qui je travaille habituellement, et qui est aussi le chanteur du groupe Psykick Lyrikah, sera ce compagnon. Ce sera déstabilisant pour lui aussi puisque je ne vais pas lui demander d’écrire des chansons de rap, je vais lui demander d’écrire un dialogue. Un dialogue métaphysique (rires). Pour écrire ce spectacle nous partirons découvrir la vie des Inuit de l’Arctique. On part en décembre dans le Nunavik.
Inuk, cela veut dire inuit au singulier : l’homme, l’individu. Puisque là-bas il y a beaucoup de chamanisme ce sera peut-être le dialogue de deux esprits animaux. Ce sera peut-être la rencontre entre un ours et un caribou, ou entre un phoque et un chien de traineau. Ce sera peut-être une discussion hors du temps, hors de l’espace sur l’homme, la femme, et sur ce que nous faisons là, sur terre.
Est-ce que ça va être un conte écologique ? Je compte trouver une réponse après ce voyage. Je sais juste que ce sera un spectacle peu bavard, tourné sur les sensations et le visuel.
Il y aura une exposition en amont du spectacle qui nettoiera un peu les clichés : le mot esquimau sera expliqué, le mot anorak, le mot kayak. Des explications pour les enfants qui diront aussi l’influence des blancs sur les problèmes que connaissent aujourd’hui les Inuit. Il y aura aussi un rapport à la Francophonie puisqu’on va le créer dans le cadre du Festival des Francophonies, et que je pars dans le Nunavik qui est la partie francophone des Inuit de l’Arctique. Là-bas, j’aurai du temps pour travailler avec des élèves autour du beat box. Le beat box nous paraissait une langue commune, proche du katadjak, le chant de gorge, qu’ils connaissent. Ne pas aller directement leur parler de Molière. Entrer plutôt en contact avec eux par rebond sur des choses ludiques.
Inuk sera une nouvelle manière de travailler. Cela instaurera un autre rapport dans l’équipe puisque soudain je serai sans savoir, sans pouvoir faire de prédictions sur l’agencement des scènes, sans avoir eu de discussion privilégiée avec le traducteur ou le dramaturge. Cette fois on part tous en même temps, et ça va recréer de l’horizontalité dans l’équipe. Ce sera au génie de chacun de s’exprimer. J’attends ça avec impatience.
Par ailleurs on commence à imaginer la possibilité que L’unijambiste ne soit pas associé qu’à mon nom, et c’est une bonne chose. La compagnie bouge pas mal. Elle accueille en son sein une mise en scène d’Emmanuelle Hiron, ma compagne, qui va créer Les Résidents. Ce spectacle est issu d’un d’une immersion de deux ans dans un EPHAD à côté de Rennes. Pendant six mois Emmanuelle est partie réaliser un documentaire avec sa caméra. A partir de ce documentaire elle a eu envie de parler de la fin de vie sur les plateaux de théâtre. Ce sera donc du théâtre documentaire. La compagnie va de l’avant et je m’en réjouis !